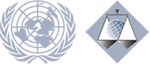| Communiqué de presse |
CHAMBRE D’APPEL
|
| (Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) |
|
La Haye, 29 juillet 2004
CT/S.I.P./875f
Arrêt de la chambre d’appel dans l’affaire le procureur contre Tihomir Blaskic
L’accusé condamné à neuf ans d’emprisonnement
Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l’arrêt rendu par la Chambre d’Appel, composée des Juges Pocar (Président), Schomburg, Mumba, Güney et Weinberg de Roca, tel que lu à l’audience de ce jour par le Juge Président :
La Chambre d’appel est réunie aujourd’hui afin de prononcer l’arrêt dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic. Le procès en l’espèce s’est ouvert le 24 juin 1997. À l’issue de celui-ci, la Chambre de première instance I de ce Tribunal a rendu son Jugement le 3 mars 2000. L’appelant Tihomir Blaskic a interjeté appel le 17 mars 2000.
Les faits de l’espèce sont liés aux crimes commis durant le conflit opposant le Conseil de défense croate (« HVO ») et l’armée des Musulmans de Bosnie (« ABiH ») dans la région de la vallée de la Lasva, en Bosnie centrale, de mai 1992 à janvier 1994. L’appelant Tihomir Blaskic était le commandant des forces armées du HVO en Bosnie centrale à l’époque des crimes reprochés.
La Chambre de première instance a reconnu l’appelant coupable, sur la base de dix-neuf chefs d’accusation figurant dans le deuxième acte d’accusation modifié, pour les crimes commis dans les municipalités de Vitez, Busovača et Kiseljak. Ces chefs d’accusation couvraient des violations des articles 2, 3 et 5 du Statut du Tribunal international. L’appelant a été déclaré coupable sur la base de l’article 7 1) du Statut pour avoir ordonné ces crimes. Dans le dispositif du Jugement, la Chambre de première instance a par ailleurs estimé qu’« en tout état de cause, il [avait], en tant que supérieur hiérarchique, omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables qui auraient permis d’empêcher que ces crimes soient commis ou d’en punir les auteurs ». En conséquence, la Chambre de première instance a également déclaré l’appelant coupable sur la base de l’article 7 3) du Statut. Elle l’a condamné à une peine unique de quarante-cinq années d’emprisonnement.
Comme il est d’usage au Tribunal, nous n’allons pas donner lecture du texte de l’arrêt, mais seulement de son dispositif. Nous allons en revanche récapituler les questions posées en appel ainsi que le raisonnement et les conclusions de la Chambre d’appel de manière à ce que vous, Tihomir Blaskic, et le public, preniez connaissance des motifs de cet arrêt. Nous insistons néanmoins sur le fait qu’il ne s’agit que d’un résumé de l’arrêt, dont il ne fait en aucune manière partie intégrante. Les seules conclusions de la Chambre d’appel faisant autorité figurent dans le texte écrit de l’arrêt, qui sera rendu public aujourd’hui à l’issue de cette audience.
Compte tenu de la complexité du présent appel, le résumé du Jugement que nous allons lire maintenant est plus long que de coutume.
La question des moyens de preuve supplémentaires
Le présent appel se caractérise par le dépôt d’un volume considérable de moyens de preuve supplémentaires. Cela s’explique, entre autres, par le manque de coopération dont a fait preuve la République de Croatie à l’époque et par le retard survenu dans l’ouverture de ses archives, lesquelles n’ont pu être accessibles qu’après le décès de l’ancien Président Franjo Tudjman le 10 décembre 1999. De ce fait, les parties en l’espèce n’ont pu disposer de ces documents lors du procès en première instance. Dans le cadre de la procédure en appel, l’appelant a déposé quatre requêtes en application de l’article 115 du Règlement de procédure et preuve du Tribunal international (le « Règlement »). Par ces requêtes, il a demandé le versement au dossier de plus de 8 000 pages de documents en tant que moyens de preuve supplémentaires. La première de ces requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires a été déposée le 19 janvier 2001, et la dernière, le 12 mai 2003.
À la suite du dépôt de la quatrième et dernière requête de l’appelant en application de l’article 115 du Règlement, et de la présentation par l’Accusation de ses moyens de preuve en réplique concernant ladite requête, la Chambre d’appel s’est prononcée sur la question des moyens de preuve supplémentaires le 31 octobre 2003 et a conclu que, dans les circonstances de l’espèce, un nouveau procès ne se justifiait pas. Elle a décidé d’admettre 108 pièces au total. En conséquence, plusieurs témoins ont été entendus lors des audiences consacrées aux moyens de preuve supplémentaires en appel qui se sont tenues du 8 au 11 décembre 2003. Les parties ont ensuite présenté leurs conclusions les 16 et 17 décembre 2003.
La Chambre d’appel a dûment examiné les moyens de preuve réunis devant elle, notamment le dossier de première instance, les moyens de preuve supplémentaires présentés par l’appelant et ceux qui ont été présentés en réplique par l’Accusation.
Les moyens d’appel
L’appelant Blaskic soulčve plusieurs moyens d’appel. S’agissant du droit applicable, il fait état d’erreurs de droit concernant les articles 2, 5 et 7 du Statut. Il fait également valoir que le deuxième acte d’accusation modifié et les violations de l’article 68 du Règlement l’ont privé de son droit à une procédure régulière. S’agissant des constatations de la Chambre de première instance, il allègue des erreurs concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Ahmici, dans certaines parties de la municipalité de Vitez autres qu’Ahmici, dans la municipalité de Busovača et dans la municipalité de Kiseljak. Il allègue aussi des erreurs de fait concernant sa responsabilité pour les crimes liés à la détention. L’appelant interjette également appel de la peine prononcée à son encontre.
Le critère d’examen en appel
La Chambre d’appel peut connaître des recours introduits contre une erreur de droit qui invalide la décision ou une erreur de fait qui a entraîné une erreur judiciaire. En l’espèce, la Chambre d’appel n’a été amenée à examiner le critère d’examen en appel que pour les conclusions contestées par la Défense, l’Accusation n’ayant pas interjeté appel.
Si la Chambre d’appel estime qu’une erreur de droit alléguée découle de l’application par la Chambre de première instance d’un critère juridique erroné, elle peut formuler le critère juridique qui convient et reconsidérer, en l’appliquant, les conclusions attaquées. Ce faisant, la Chambre d’appel non seulement corrige une erreur de droit, mais applique aussi le critère juridique qui convient aux éléments de preuve figurant dans le dossier de première instance, en l’absence de moyens de preuve supplémentaires, et doit déterminer si elle est elle-même convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, du bien-fondé de la constatation attaquée avant de la confirmer en appel.
S’agissant des erreurs de fait alléguées, la Chambre d’appel applique le critère dit du « caractère raisonnable », lequel consiste à déterminer si aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre d’appel garde à l’esprit que lorsqu’elle déterminera si la Chambre de première instance est parvenue à une conclusion raisonnable, elle ne modifiera pas à la légère les constatations rendues en première instance.
La Chambre d’appel souscrit à la conclusion énoncée dans l’Arrêt Kupreskic selon laquelle
si la Chambre d’appel est convaincue que la Chambre de première instance a déclaré l’accusé coupable sur la base d’un élément de preuve qu’aucun juge du fait raisonnable n’aurait admis, ou que le jugement porté sur les éléments de preuve est « totalement erroné », elle annulera la déclaration de culpabilité puisqu’en pareilles circonstances, aucun juge du fait raisonnable n’aurait pu être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de la participation de l’accusé à un acte criminel.
La Chambre d’appel considère qu’elle n’a aucune raison de s’écarter du critère énoncé ci-dessus pour se prononcer sur les moyens où l’appelant ne relève que des erreurs de fait et dès lors qu’aucun moyen de preuve supplémentaire n’aura été admis en appel. La Chambre appliquera s’il y a lieu ce critère dans l’Arrêt.
Lorsque des erreurs de fait sont alléguées sur la base de moyens de preuve supplémentaires présentés en appel, l’article 117 du Règlement dispose que la Chambre d’appel rend son arrêt « en se fondant sur le dossier d’appel et, le cas échéant, sur les nouveaux éléments de preuve qui lui ont été présentés ».
Dans l’Arrêt Kupreskic, la Chambre d’appel a fixé le critère d’examen applicable lorsque des moyens de preuve supplémentaires sont admis en appel. Elle a déclaré à ce propos :
Le critère qu’elle a décidé d’appliquer pour déterminer s’il convient ou non de confirmer la déclaration de culpabilité lorsque des moyens de preuve supplémentaires ont été admis en appel est le suivant : l’appelant a-t-il établi qu’aucun juge du fait n’aurait pu [raisonnablement] déclarer l’accusé coupable au vu des éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance, et des moyens de preuve supplémentaires admis en appel ?
Le critère d’examen appliqué par la Chambre d’appel dans cette affaire consistait à déterminer si un juge du fait aurait pu raisonnablement être convaincu au-delà de tout doute raisonnable du bien-fondé de la conclusion attaquée, un critère fondé sur la retenue. Dans ce cas, la Chambre d’appel saisie de l’affaire Kupreskic n’a pas déterminé si elle était elle-même convaincue au-delà de tout doute raisonnable du bien-fondé de la conclusion attaquée. Il est vrai qu’il n’y avait pas lieu de le faire puisque le cas était tel qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité des appelants.
Toutefois, dans le cas où un juge du fait pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, la Chambre d’appel considère que lorsqu’elle est elle-même chargée d’apprécier, ensemble, les éléments de preuve présentés en première instance et les moyens de preuve supplémentaires admis en appel, en appliquant dans certains cas un critère juridique nouvellement formulé, elle devrait, dans l’intérêt de la justice, être elle-même convaincue au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant avant de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre. La Chambre d’appel souligne que dans ce cas, si elle devait appliquer un critère moins exigeant, ni la Chambre de première instance, ni la Chambre d’appel n’aurait conclu, au-delà de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’appelant en se fondant sur la totalité des éléments de preuve considérés dans l’affaire et appréciés en appliquant le critère juridique qui convient.
Pour conclure, lorsque la Chambre d’appel devra se prononcer sur une erreur mettant en cause le critère juridique appliqué dans la constatation et sur une erreur de fait alléguée et lorsque des moyens de preuve supplémentaires auront été admis en appel, elle procèdera en deux temps :
i) La Chambre d’appel appliquera le critère juridique qui convient aux moyens de preuve figurant dans le dossier de première instance et déterminera si elle est elle-même convaincue au-delà de tout doute raisonnable du bien-fondé de la déclaration de culpabilité, au vu du dossier de première instance. Si tel n’est pas le cas, il n’est point besoin d’examiner la question en droit.
ii) Si, toutefois, la Chambre d’appel, appliquant le critère juridique qui convient aux moyens de preuve figurant dans le dossier de première instance, est elle-même convaincue au-delà de tout doute raisonnable du bien-fondé de la déclaration de culpabilité, elle en viendra alors à déterminer si, au vu des éléments de preuve réunis en première instance et appréciés globalement avec les moyens de preuve supplémentaires admis en appel, elle est elle-même toujours convaincue au-delà de tout doute raisonnable du bien-fondé de la déclaration de culpabilité.
Ce critère d’examen complète celui qu’a appliqué la Chambre d’appel dans l’affaire Kupreskic.
Nous allons maintenant exposer plus en détail les conclusions de la Chambre d’appel pour chacun des moyens d’appel soulevés.
1. Erreurs de droit alléguées concernant l’article 7 du Statut
a) Article 7 1) du Statut
L’appelant conteste les critères exposés dans le Jugement rendu en première instance, s’agissant des formes de responsabilité pénale énoncées à l’article 7 1) du Statut.
L’appelant n’a pas été déclaré coupable d’avoir planifié ou incité à commettre des crimes. La question examinée par la Chambre d’appel est de savoir si le critère de l’élément moral (mens rea), moins rigoureux que celui de l’intention directe, peut être appliqué au fait d’ordonner un crime au sens de l’article 7 1) du Statut.
Au paragraphe 474 du Jugement rendu en l’espèce, la Chambre de première instance a énoncé le critère suivant :
Toute personne qui, en ordonnant un acte, sait qu’il y a un risque que des crimes soient commis et accepte de prendre ce risque, manifeste le niveau d’intention nécessaire (le dol éventuel) pour voir sa responsabilité engagée pour avoir ordonné, planifié ou incité à commettre les crimes.
Bien que la Chambre de première instance ait indiqué que le critère énoncé au paragraphe 474 avait déjà été expliqué plus haut dans le Jugement, l’examen des paragraphes précédents relatifs aux éléments juridiques requis par l’article 7 du Statut révèle que tel n’est pas le cas. D’autres paragraphes du Jugement font état du critère énoncé au paragraphe 474 en utilisant d’autres formulations.
Après avoir examiné les approches adoptées par les systèmes nationaux ainsi que la jurisprudence du Tribunal international, la Chambre d’appel considère que la Chambre de première instance a exposé de façon erronée la mens rea qui s’attache au fait d’ordonner un crime au sens de l’article 7 1) du Statut. Le fait d’avoir connaissance d’un risque, quel qu’il soit et aussi minime soit-il, ne suffit pas à engager la responsabilité pénale de l’appelant pour des violations graves du droit international humanitaire. La Chambre de première instance ne précise pas le degré de risque qu’il convient d’établir. Il semble bien qu’en appliquant le critère formulé par la Chambre de première instance, tout commandant militaire qui émet un ordre serait pénalement responsable car il existe toujours la possibilité que des violations soient commises.
La Chambre d’appel conclut que quiconque ordonne un acte ou une omission, en sachant qu’il est très probable qu’un crime résultera de l’exécution de cet ordre, est animé de l’élément moral requis pour que sa responsabilité au sens de l’article 7 1) du Statut soit engagée, pour ce qui est du fait d’ordonner. Le fait de donner un ordre dans ces conditions revient à accepter le crime en question.
L’appelant conteste également les conclusions de la Chambre de première instance relatives à l’élément moral et à l’élément matériel requis pour constituer la complicité par aide et encouragement. Dans ce cas, la Chambre de première instance a correctement appliqué le critère formulé dans le Jugement Furundžija, s’agissant de l’élément matériel de la complicité par aide et encouragement.
En ce qui concerne l’élément moral requis pour établir la complicité par aide et encouragement, la Chambre de première instance a déclaré qu’outre le fait qu’il ait eu connaissance que ses actes contribuaient à la perpétration du crime, le complice doit avoir eu l’intention de fournir une assistance ou, tout au moins, avoir eu conscience que cette assistance serait une conséquence possible et prévisible de son comportement. Comme il est indiqué dans l’Arrêt Vasiljevic, s’agissant de la complicité, l’élément moral requis est le fait de savoir que les actes commis par le complice contribuent à la perpétration d’un crime précis par l’auteur principal. À cet égard, la Chambre de première instance en l’espèce a commis une erreur.
Par conséquent, la Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a eu raison sur certains points, et tort sur d’autres, lorsqu’elle a énoncé les éléments juridiques requis pour la complicité par aide et encouragement. La Chambre de première instance n’a toutefois pas tenu l’appelant responsable pour avoir aidé et encouragé les crimes reprochés. En outre, la Chambre d’appel considère que ce mode de participation n’a pas été suffisamment débattu en appel et qu’il n’a pas été dûment couvert par le deuxième acte d’accusation modifié. La Chambre d’appel se refuse donc à poursuivre plus avant l’examen de ce mode de participation.
b) Article 7 3) du Statut
L’appelant fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu’elle a interprété l’élément de connaissance requis par l’article 7 3) du Statut. S’agissant des commandants, la Chambre de première instance a conclu que « leur mission leur impose d’être continuellement informés de la manière dont leurs subordonnés s’acquittent des tâches qui leur sont confiées et de prendre les mesures nécessaires à cet effet ».
La Chambre d’appel est d’avis que l’Arrêt Celebici a tranché cette question et qu’un supérieur ne peut être tenu pour pénalement responsable que s’il avait à sa disposition des informations particulières l’avertissant des infractions commises par ses subordonnés. Le fait de manquer à son obligation d’obtenir de telles informations ne constitue pas une infraction séparée au sens de l’article 7 3) du Statut. Un supérieur ne sera donc pas tenu responsable pour de tels manquements, mais seulement pour avoir omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables qui auraient permis d’empêcher que les crimes en cause soient commis ou d’en punir les auteurs. L’interprétation de ce critère telle qu’exposée dans le Jugement rendu en première instance ne cadre pas avec la jurisprudence de la Chambre d’appel sur ce point, et nous la corrigeons en conséquence.
Dans l’acte d’accusation, la responsabilité de l’appelant est mise en cause à la fois sur la base de l’article 7 1) et sur celle de l’article 7 3) du Statut. Au vu des conclusions qu’elle a tirées au sujet de certains événements et du dispositif adopté, il est manifeste que la Chambre de première instance a examiné les questions de fond relatives à ces événements selon la double optique de l’article 7 1) et de l’article 7 3) du Statut.
La Chambre d’appel doit cependant faire état de ses préoccupations concernant le dispositif du Jugement, dans lequel la Chambre de première instance, ayant déclaré l’appelant coupable d’avoir ordonné des persécutions et d’avoir commis d’autres infractions sur la base des mêmes constatations, estime qu’en tout état de cause, il a, en tant que supérieur hiérarchique, omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables qui auraient permis d’empêcher que ces crimes soient commis ou d’en punir les auteurs. Cette déclaration, dans laquelle il est fait référence à la responsabilité de l’appelant au sens de l’article 7 3) du Statut, représente un cas de double déclaration de culpabilité, prononcée à la fois sur la base de l’article 7 1) et de l’article 7 3) du Statut, ce qui contredit l’opinion correctement exprimée au paragraphe 337 du Jugement, où il est dit :
Il serait illogique de tenir un commandant pour pénalement responsable d’avoir planifié, instigué ou ordonné la perpétration de crimes et, simultanément, de lui reprocher de ne pas les avoir empêchés ou sanctionnés. En revanche, ainsi que l’avance l’Accusation, l’omission de punir des crimes passés, qui engage la responsabilité du commandant au titre de l’article 7 3) peut, sous réserve que soient remplies les conditions d’éléments moral et matériel, engager la responsabilité du commandant au titre de l’article 7 1) du Statut, à raison soit de l’aide et de l’encouragement, soit de l’incitation, à la perpétration ultérieure, de nouveaux crimes.
Les dispositions de l’article 7 1) et celles de l’article 7 3) du Statut renvoient à des catégories distinctes de responsabilité pénale. On ne saurait déclarer un accusé coupable d’un même chef, sur la base à la fois de l’article 7 1) et de l’article 7 3) du Statut. Lorsque la responsabilité de l’accusé est mise en cause sur la base de ces deux articles pour le même chef, et que les éléments juridiques requis pour ces deux formes de responsabilité sont réunis, la Chambre de première instance devrait prononcer une déclaration de culpabilité sur la seule base de l’article 7 1) et retenir la position de supérieur hiérarchique de l’accusé comme une circonstance aggravante.
En l’espèce, la Chambre d’appel estime par conséquent que le fait de déclarer l’appelant coupable sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut, pour les mêmes chefs et à raison des mêmes actes, comme il ressort du dispositif du Jugement, constitue une erreur de droit de nature à invalider le Jugement sur ce point. De plus, lorsque la Chambre de première instance n’a pas formulé de constatations sur la base de l’article 7 3) du Statut, la Chambre d’appel n’a pas pris en considération cette forme particulière de responsabilité, nonobstant la déclaration générale à son sujet qui est incluse dans le dispositif du Jugement.
2. Erreurs de droit alléguées concernant l’article 5 du Statut
L’appelant soutient que la Chambre de première instance a commis plusieurs erreurs importantes en interprétant et en appliquant les conditions d’application de l’article 5 du Statut visant les crimes contre l’humanité. Ce moyen d’appel porte sur plusieurs points.
S’agissant de la condition selon laquelle l’attaque doit être généralisée ou systématique, la Chambre d’appel a examiné la définition qu’a donnée la Chambre de première instance de cet élément requis pour les crimes contre l’humanité et conclut qu’elle n’a commis aucune erreur en l’analysant.
S’agissant de la condition selon laquelle l’attaque doit être dirigée contre une population civile, les éléments pertinents ont été énoncés dans l’Arrêt Kunarac : c’est à la fois le statut de civil de la victime et l’ampleur de l’attaque ou son degré d’organisation qui caractérisent les crimes contre l’humanité.
Pour déterminer ce que recouvre l’expression « population civile », la Chambre d’appel considère que la présence au sein de cette population de résistants ou de combattants ayant déposé les armes ne modifie pas le caractère civil de celle-ci. La Chambre de première instance avait raison sur ce point. Elle s’est toutefois en partie fourvoyée lorsqu’elle a défini la population civile et les civils visés à l’article 5 du Statut, déclarant que la situation concrète de la victime au moment où les crimes sont commis, plutôt que son statut, doit être pris en compte pour déterminer sa qualité de civil. La situation concrète de la victime au moment où les crimes sont commis peut ne rien changer au fait qu’elle a ou non le statut de civil. Si une personne fait effectivement partie d’une organisation armée, le fait qu’elle ne soit pas armée ou qu’elle soit hors de combat au moment où les crimes sont commis ne fait pas d’elle un civil.
La Chambre d’appel considère en outre qu’afin de déterminer si la présence de soldats au sein d’une population modifie le caractère civil de celle-ci, le nombre de ces soldats et s’ils sont en permission doit être pris en compte ; elle conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en déclarant que la présence de soldats, au sein d’une population civile qui fait l’objet d’une attaque délibérée, ne modifie pas le caractère civil de celle-ci.
S’agissant de la condition selon laquelle les actes de l’accusé et l’attaque proprement dite doivent s’inscrire dans le cadre d’une politique ou d’un plan criminels préétablis, la Chambre d’appel rappelle ce qu’elle a déclaré dans l’Arrêt Kunarac, à savoir que l’existence d’un plan ou d’une politique ne fait pas partie des éléments juridiques des crimes contre l’humanité, même si elle peut permettre d’établir qu’il existait une attaque dirigée contre une population civile et que cette attaque était généralisée ou systématique. Le Jugement rendu en première instance n’était pas clair sur cette question de droit.
S’agissant de la condition selon laquelle l’accusé savait que ses actes s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque plus vaste, la Chambre d’appel considère que l’élément moral requis pour les crimes contre l’humanité est satisfait lorsque l’accusé est animé de l’intention requise pour commettre le ou les crimes sous-jacents qui lui sont reprochés et lorsqu’il connaît l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile et qu’il sait que ses actes s’inscrivent dans le cadre de cette attaque. Comme elle l’explique dans l’Arrêt, la Chambre d’appel conclut que la Chambre de première instance s’est en partie fourvoyée lorsqu’elle a énoncé la mens rea s’attachant aux crimes contre l’humanité.
S’agissant de l’élément matériel des persécutions constitutives de crime contre l’humanité
La Chambre d’appel estime que la jurisprudence du Tribunal international définit les persécutions constitutives de crime contre l’humanité. Dans le Jugement, la Chambre de première instance a toutefois donné une définition des persécutions selon laquelle l’élément matériel englobe les atteintes portées aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Ce faisant, elle n’a pas vérifié si les actes sous-jacents en question étaient assimilables à des persécutions en tant que crime contre l’humanité en droit international coutumier. La Chambre de première instance a commis une erreur sur ce point.
Comme elle s’en explique dans l’Arrêt, la Chambre d’appel a considéré chacun des types de comportement examinés par la Chambre de première instance. Sont en cause l’homicide (ou meurtre/assassinat) et le fait de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ; les destructions et pillages de biens ; l’expulsion, le transfert forcé et le déplacement forcé ; les traitements inhumains infligés aux civils ; et les attaques menées contre des villes et des villages.
En conclusion, la Chambre d’appel estime qu’il ressort clairement de l’analyse qu’a faite la Chambre de première instance du droit applicable aux persécutions qu’elle n’a pas pris en considération la condition selon laquelle les persécutions doivent présenter le même degré de gravité que les autres crimes énumérés à l’article 5 du Statut. La Chambre d’appel fait observer qu’il ne suffit pas que les actes sous-jacents aient été commis avec une intention discriminatoire et conclut que la Chambre de première instance s’est fourvoyée sur ce point.
S’agissant de l’élément moral des persécutions constitutives de crime contre l’humanité
La Chambre d’appel précise que le droit n’exige pas l’existence chez l’auteur d’une « intention visant à persécuter » s’ajoutant à l’intention discriminatoire déjà requise pour les persécutions. La Chambre d’appel souligne aussi que pour établir l’intention d’un auteur de persécutions, il faut prouver qu’il a l’intention spécifique d’exercer une discrimination pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. La Chambre de première instance a conclu à juste titre que l’intention qui inspire les persécutions est « l’intention spéciale d’atteindre une personne humaine en tant qu’appartenant à telle communauté ou à tel groupe ».
En second lieu, la Chambre d’appel reconnaît que dans ses constatations sur le fait d’ordonner des crimes au sens de l’article 7 1) du Statut, la Chambre de première instance a fréquemment employé des expressions comme « il a pris le risque » ou « il a pris le risque de manière délibérée ». La Chambre d’appel a défini plus haut l’élément moral qui s’attache au fait d’ordonner un crime sans qu’il y ait intention directe. En conséquence, quiconque donne un ordre en sachant qu’il est très probable que des persécutions constitutives de crime contre l’humanité résultent de l’exécution de cet ordre peut être tenu responsable de persécutions sur la base de l’article 7 1) du Statut. Le fait de donner un ordre dans ces conditions revient à accepter le crime en question.
3. Erreurs de droit alléguées concernant l’article 2 du Statut
Les infractions visées à l’article 2 du Statut doivent être dirigées contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions des Conventions de Genève. Le premier alinéa de l’article 4 de la IVe Convention de Genève définit les personnes protégées comme celles « qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes ». Dans l’Arrêt Tadic, la Chambre d’appel a conclu que cette disposition visait à assurer la protection maximale possible aux civils et que même si les auteurs des crimes et leurs victimes pouvaient être considérés en l’espèce comme étant de même nationalité, l’article 4 demeurerait applicable.
Appliquant les mêmes principes en relation avec le conflit entre les Croates de Bosnie et les Musulmans de Bosnie, la Chambre d’appel, dans l’Arrêt Aleksovski, a jugé que puisque le conflit était international en raison de la participation de la Croatie, il s’ensuivait que les victimes musulmanes de Bosnie se trouvaient au pouvoir de la Croatie, une Partie au conflit dont elles n’étaient pas ressortissantes et qu’en conséquence, l’article 4 de la IVe Convention de Genève était applicable. Dans l’Arrêt Celebici, la Chambre d’appel a réaffirmé ces principes et les a développés en considérant les effets de leur application dans le cas de Serbes de Bosnie détenus par des Musulmans de Bosnie.
La Chambre d’appel considère comme infondé l’argument de l’appelant selon lequel d’après le « critère de l’allégeance », les Croates de Bosnie tombés aux mains des Musulmans de Bosnie ne seraient pas considérés comme des personnes protégées. Elle considère également comme infondé l’argument de l’appelant selon lequel la présente espèce peut se distinguer des affaires Tadic et Celebici puisque, contrairement aux Croates de Bosnie, les Serbes de Bosnie cherchaient à faire sécession de la Bosnie-Herzégovine.
La Chambre d’appel a précédemment rejeté les arguments concernant le fait que les victimes ne devraient pas avoir le statut de « personnes protégées » si l’on interprète à la lettre l’article 4 de la IVe Convention de Genève. Elle est donc convaincue qu’il n’y a pas eu violation du principe de la légalité en l’espèce. La Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance n’a commis aucune erreur sur ce point.
L’appelant avance en outre que la condition selon laquelle les victimes doivent être des « personnes protégées » se fonde sur l’article 4, alinéa 2 de la IVe Convention de Genève disposant que « les ressortissants d’un État co-belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l’État dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent ».
La Chambre d’appel considère qu’il ressort clairement à la fois de l’article 4, alinéa 2 et de son commentaire que pour que cette disposition s’applique, il faut démontrer premièrement que les États étaient alliés et deuxièmement, que les démarches faites par le représentant diplomatique de chaque État auprès de l’autre ont été efficaces et satisfaisantes. La Croatie et la Bosnie-Herzégovine étaient engagées dans un conflit qui les opposaient l’une à l’autre. Cela suffit à établir qu’elles n’étaient pas des États co-belligérants au sens de l’article 4 alinéa 2. Ce moyen d’appel est donc rejeté.
4. Erreurs alléguées concernant la violation du droit à une procédure régulière
L’appelant avance qu’il a injustement été privé du droit à un procès équitable prévu par l’article 21 du Statut du Tribunal international, et ce pour deux raisons principales : i) il a été jugé et déclaré coupable sur la base d’un acte d’accusation « dangereusement vague » ; et ii) l’Accusation n’a pas respecté les obligations que lui impose l’article 68 du Règlement en matière de communication des éléments de preuve à décharge. L’appelant soutient qu’il a ainsi été privé du droit à une procédure régulière et que cette violation a sérieusement compromis la préparation et la présentation de sa défense.
a) Caractère vague de l’Acte d’accusation
Le 21 novembre 1996, le premier acte d’accusation a été modifié afin de mettre en cause l’appelant sous dix-neuf chefs d’accusation. Le 4 avril 1997, la Chambre de première instance a fait droit à l’exception préjudicielle de l’appelant pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié et a ordonné à l’Accusation d’apporter de nouvelles modifications à l’acte d’accusation. L’Accusation a déposé un deuxième acte d’accusation modifié le 25 avril 1997. L’appelant a contesté derechef le deuxième acte d’accusation modifié et la Chambre de première instance, dans une deuxième décision rendue le 10 juin 1997, a dit que le deuxième acte d’accusation était entaché de vices de forme ; elle a toutefois décidé de commencer le procès sans ordonner à l’Accusation de modifier le deuxième acte d’accusation modifié.
L’appelant ayant soulevé la question à deux reprises devant la Chambre de première instance et ayant reçu de sa part l’assurance formelle qu’elle ne manquerait pas de tirer au procès toutes les conséquences juridiques découlant d’éventuels manquements de l’Accusation à certaines de ses obligations, voire à toutes, dans la mesure où ces éventuels manquements, entre autres, auraient pu empêcher l’accusé de préparer sa défense, la Chambre d’appel considère que l’appelant était en droit de croire que la Chambre de première instance respecterait l’engagement pris avant le procès et conclut que l’appelant n’a pas renoncé à son droit de soulever en appel la question touchant au caractère vague de l’acte d’accusation.
Ayant analysé le deuxième acte d’accusation modifié selon les principes gouvernant l’exposé des faits, énoncés dans l’Arrêt, la Chambre de première instance conclut que le deuxième acte d’accusation modifié n’expose pas les faits essentiels de manière suffisamment précise, et qu’en conséquence, il ne respecte pas les principes gouvernant l’exposé des faits, tels qu’énoncés dans l’Arrêt.
L’examen du dossier de première instance auquel a procédé la Chambre d’appel donne toutefois à penser que l’Accusation a présenté clairement lors du procès les informations nécessaires pour avertir l’appelant de la nature des accusations portées contre lui. La Chambre d’appel conclut que les vices de forme entachant le deuxième acte d’accusation modifié n’ont pas empêché l’appelant de préparer sa défense et qu’en conséquence, ils n’ont pas compromis l’équité de son procès. La Chambre d’appel rejette donc le moyen d’appel sur ce point.
b) Violations présumées de l’article 68 du Règlement
L’appelant avance que l’Accusation a violé l’article 68 du Règlement en s’abstenant de communiquer les pièces 2, 16 et 25 visées par la deuxième requête en application de l’article 115 du Règlement, ainsi que la pièce H1.
Pour ce qui est de la pièce 2, la Chambre d’appel conclut que l’Accusation n’a pas violé l’article 68 du Règlement. Pour ce qui est des pièces 16 et 25, elle conclut que l’appelant n’a pas subi de préjudice important. S’agissant de la pièce H1, la Chambre d’appel considère que le fait que l’Accusation ne l’a pas communiquée constitue une violation des obligations qu’impose à celle-ci l’article 68. Toutefois, étant donné que l’appelant a pu citer le témoin Watkins lors des audiences en appel, la Chambre d’appel conclut que le préjudice causé à l’appelant a été réparé.
En conséquence, même si elle considère que l’Accusation a effectivement violé l’article 68, vu qu’il n’en a résulté aucun préjudice important pour l’appelant en l’espèce, la Chambre d’appel rejette le moyen d’appel sur ce point.
5. Erreurs alléguées concernant la responsabilité de l’appelant pour les crimes commis à Ahmici et dans les environs
Responsabilité de l’appelant au sens de l’article 7 1) du Statut
La Chambre de première instance a déclaré l’appelant coupable sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les crimes dirigés contre la population civile musulmane et commis après qu’il eut donné l’ordre à la brigade Viteska, à la brigade Nikola Šubic Zrinski, au IVe bataillon de police militaire, aux Jokeri, aux Vitezovi et aux Domobrani de lancer une offensive contre Ahmici et les villages environnants. La Chambre d’appel considčre que la déclaration de culpabilité de l’appelant prononcée sur la base de l’article 7 1) se fonde sur les constatations suivantes de la Chambre de première instance : i) l’attaque était organisée, planifiée au plus haut niveau de la hiérarchie militaire et dirigée contre la population civile musulmane d’Ahmici ; ii) la police militaire, les Jokeri, les Domobrani et des unités régulières du HVO (dont la brigade Viteska) ont participé aux combats et les attaques n’étaient justifiées par la présence d’aucun objectif militaire ; et iii) l’appelant avait les pouvoirs d’un supérieur hiérarchique sur la brigade Viteska, les Domobrani, le IVe bataillon de police militaire et les Jokeri durant la période considérée.
Au soutien de la déclaration de culpabilité qu’elle a prononcée contre l’appelant sur la base de l’article 7 1), la Chambre de première instance a constaté que la pièce D269 était « très clairement » un ordre d’attaque adressé aux forces de la brigade Viteska, du IVe bataillon de police militaire, de la brigade Nikola Šubic Zrinski et de la police civile dont la Chambre de premičre instance a déclaré qu’elles avaient été reconnues sur le terrain comme celles qui avaient mené le combat.
La Chambre d’appel considère que l’appréciation qu’a portée la Chambre de première instance sur la pièce D269 telle qu’elle apparaît dans le Jugement est très différente de celle que la Chambre d’appel a elle-même portée sur cette pièce lorsqu’elle l’a examinée. La Chambre d’appel estime que l’appréciation de la Chambre de première instance est totalement erronée.
La Chambre d’appel considère que les éléments de preuve présentés au procès n’étayent pas la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les forces de l’ABiH n’étaient pas en train de préparer des attaques à Ahmici et dans les environs. Par ailleurs, la Chambre d’appel note que les moyens de preuve supplémentaires admis en appel attestent une présence militaire musulmane à Ahmici et que l’appelant avait des raisons de croire que l’ABiH avait l’intention de mener une attaque le long de l’axe Ahmici-Šantici-Dubravica. En conséquence, la Chambre d’appel considčre que les nécessités militaires justifiaient que l’appelant donne l’ordre présenté sous la cote D269.
Vu l’analyse qu’elle a faite de l’interprétation de la Chambre de première instance à propos de la pièce D269 et les éléments de preuve pertinents réunis devant la Chambre de première instance, la Chambre d’appel conclut qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure que l’ordre présenté sous la cote D269 avait été donné « avec la claire intention que le massacre [fût] commis » ou qu’il était à l’origine des crimes commis à Ahmici le 16 avril 1993.
La Chambre de première instance a constaté que non seulement la police militaire et les Jokeri, mais aussi des unités régulières du HVO, notamment la brigade Viteska, avaient participé aux combats à Ahmici et dans les environs le 16 avril 1993 et a conclu que les exactions commises n’avaient pas été le seul fait de la police militaire mais qu’elles impliquaient aussi les unités régulières du HVO, notamment la brigade Viteska, ainsi que les Domobrani.
La Chambre d’appel considère que la conclusion selon laquelle la brigade Viteska et les Domobrani ont pris part aux exactions commises durant l’attaque contre Ahmici et les villages environnants, au vu du dossier de premičre instance, n’était pas suffisamment fondée. La Chambre d’appel souligne que les moyens de preuve supplémentaires admis en appel remettent sérieusement en cause cette conclusion et indiquent que les crimes commis à Ahmici et dans les environs le 16 avril 1993 ont été perpétrés par les Jokeri et par le IVe bataillon de police militaire. Pour ces raisons, la Chambre d’appel estime que la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les exactions commises « impliquaient aussi les unités régulières du HVO, notamment la brigade Viteska, ainsi que les Domobrani » ne peut pas être confirmée en appel.
La Chambre d’appel considère que certains documents admis en tant que moyens de preuve supplémentaires en appel confirment que les exactions commises le 16 avril 1993 à Ahmici et dans les environs ont été le fait du IVe bataillon de police militaire et des Jokeri et désignent d’autres unités comme responsables d’avoir planifié et ordonné le massacre.
La Chambre de première instance a conclu que puisque l’appelant savait que certaines unités engagées dans l’attaque contre Ahmici s’étaient précédemment rendues coupables de crimes contre la population musulmane de Bosnie ou qu’il y avait des criminels au sein de ces unités, lorsqu’il a donné l’ordre à ces troupes de lancer une attaque contre le village d’Ahmici conformément à la pièce D269, l’appelant a délibérément pris le risque que des exactions soient commises contre la population civile musulmane d’Ahmici et contre ses biens.
La Chambre d’appel a défini l’élément moral qui s’attache au fait d’ordonner un crime au sens de l’article 7 1) du Statut, sans qu’il y ait intention directe. La Chambre de première instance n’a pas appliqué ce critère lorsqu’elle a déclaré l’appelant coupable sur la base de l’article 7 1). L’analyse des éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Chambre de première instance porte à conclure que des mesures concrètes ont été prises pour empêcher que des crimes ne soient commis et pour écarter les criminels connus. La Chambre d’appel estime que les ordres et les rapports sur lesquels s’est fondée la Chambre de première instance ne sont pas suffisamment probants pour satisfaire au critère juridique formulé par la Chambre d’appel.
En conséquence, la Chambre d’appel n’est pas convaincue que les éléments de preuve pertinents réunis au procès en première instance et appréciés globalement avec les moyens de preuve supplémentaires admis en appel prouvent au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant est responsable, sur la base de l’article 7 1) du Statut, d’avoir ordonné les crimes commis à Ahmici et dans les villages environnants le 16 avril 1993.
Responsabilité de l’appelant au sens de l’article 7 3) du Statut
La Chambre d’appel observe qu’après avoir déclaré l’appelant coupable sur la base de l’article 7 1) du Statut, la Chambre de première instance l’a également déclaré coupable sur celle de l’article 7 3) pour sa responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique.
La Chambre d’appel conclut que vu les éléments de preuve pertinents réunis devant la Chambre de première instance, et en particulier le fait que l’appelant a reconnu que des troupes de la police militaire pouvaient lui être détachées pour des missions ponctuelles suite à certaines requêtes, un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure, comme l’a fait la Chambre de première instance, que l’appelant avait les pouvoirs d’un supérieur hiérarchique sur la police militaire.
La Chambre d’appel a déterminé si, au vu des éléments de preuve réunis en première instance et appréciés globalement avec les moyens de preuve supplémentaires admis en appel, elle était elle-même convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant exerçait un contrôle effectif sur la police militaire.
La Chambre d’appel considère que les moyens de preuve admis en appel a) montrent que certains membres de la police militaire avaient des agissements criminels ; b) donnent à penser que la police militaire bénéficiait de la protection d’autres personnes et agissait souvent sur leur ordre ; et c) portent encore davantage à conclure que les membres de la police militaire ne reconnaissaient pas l’autorité de l’appelant et n’exécutaient pas ses ordres. La Chambre d’appel a également entendu des témoignages en appel indiquant que les unités de la police militaire, notamment les Jokeri, n’étaient pas de facto commandées par l’appelant.
La Chambre d’appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en interprétant l’élément moral « il avait des raisons de savoir ». Son analyse des moyens de preuve sur lesquels se fonde la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l’appelant savait que des crimes avaient été commis ou étaient sur le point de l’être, révèle que rien n’indique que l’appelant disposait d’informations l’avertissant des crimes commis par ses subordonnés à Ahmici et dans les environs le 16 avril 1993. De surcroît, les moyens de preuve supplémentaires admis en appel viennent appuyer l’argument de l’appelant selon lequel il n’avait aucune raison de croire que des crimes avaient été commis compte tenu du conflit opposant à l’époque le HVO et l’ABiH.
La Chambre d’appel considère que les éléments de preuve réunis en première instance et appréciés globalement avec les moyens de preuve admis en appel montrent que l’appelant a pris les mesures raisonnables qu’il était en mesure de prendre pour dénoncer les crimes commis, et fondent la conclusion selon laquelle l’appelant a demandé l’ouverture d’une enquête sur les crimes commis à Ahmici, enquête qui a été menée par le Service d’information et de sécurité de Mostar et dont les résultats n’ont pas été communiqués à l’appelant, pas plus que les noms des auteurs de ces crimes.
Pour les raisons susmentionnées, ayant examiné les conditions d’application de l’article 7 3) du Statut relatives à la responsabilité, la Chambre d’appel conclut que l’appelant n’exerçait pas un contrôle effectif sur les unités militaires responsables des crimes commis à Ahmici et dans les environs le 16 avril 1993 au sens où il n’avait pas la capacité matérielle d’empêcher ces crimes ou d’en punir les auteurs, et qu’en conséquence, les conditions requises pour que s’applique le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique ne sont pas remplies. La Chambre d’appel n’est donc pas convaincue que les éléments de preuve réunis en première instance et appréciés globalement avec les moyens de preuve supplémentaires admis en appel établissent au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant est responsable au sens de l’article 7 3) du Statut pour avoir manqué à l’obligation d’empêcher les crimes commis à Ahmici et dans les environs le 16 avril 1993 ou d’en punir les auteurs.
6. Erreurs alléguées concernant la responsabilité de l’appelant pour les crimes commis dans d’autres parties de la municipalité de Vitez
L’argument principal avancé par l’appelant est que la Chambre de première instance a commis une erreur en attribuant à l’appelant la responsabilité des crimes commis dans le cadre des opérations militaires menées dans la municipalité de Vitez du fait qu’il était le commandant du HVO dans la région. Pourtant, l’appelant n’a jamais contesté le fait qu’il était de jure le commandant des unités régulières du HVO en Bosnie centrale, en général, ou qu’il a ordonné certaines opérations militaires dans la municipalité de Vitez en 1993.
La conclusion selon laquelle l’appelant est coupable d’avoir ordonné certains crimes et d’avoir manqué à son obligation d’empêcher ces crimes ou d’en punir les auteurs après coup ne saurait toutefois se fonder exclusivement sur le fait que l’appelant était de jure le commandant des auteurs des crimes. Par ailleurs, la Chambre d’appel considère que dans le cadre d’un conflit armé comme celui en cause, préparé de longue date et opposant deux camps, la question de savoir quelle partie a déclenché les hostilités n’est pas pertinente pour déterminer la nature de ses actions durant le conflit. Ce qui intéresse le Tribunal international, c’est de savoir si des crimes ont été commis et par qui.
a) Responsabilité de l’appelant au sens de l’article 7 1) du Statut
S’agissant des attaques du 16 avril 1993 sur la ville de Vitez, la Chambre d’appel reconnaît qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure, tout comme l’a fait la Chambre de première instance, que l’attaque lancée contre les unités de l’ABiH présentes dans la ville de Vitez était illégale.
Cependant, au vu des moyens de preuves supplémentaires, la Chambre d’appel n’estime pas qu’il ait été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que l’attaque était dirigée contre une cible civile, ni qu’elle visait la population civile de la ville de Vitez, et elle considère que l’on ne peut s’appuyer sur les constatations de la Chambre de première instance quant au nombre de victimes civiles occasionnées par l’offensive du 16 avril pour déterminer la nature de cette attaque.
De surcroît, aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure, sur la base des éléments de preuve présentés en première instance, que l’appelant savait que des crimes risquaient d’être commis au cours de l’attaque. A fortiori les éléments de preuve présentés en première instance ne peuvent satisfaire au-delà de tout doute raisonnable le critère juridique édicté par la Chambre d’appel dans le présent Arrêt.
S’agissant du camion piégé du 18 avril 1993, la Chambre d’appel souscrit à la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l’explosion du camion piégé constituait un attentat terroriste et un crime contre l’humanité. Cependant, la Chambre de première instance n’a cité aucun élément prouvant que l’explosion résultait d’un ordre donné par l’appelant.
La Chambre d’appel a minutieusement passé en revue les éléments de preuve pertinents présentés en première instance, au cours de l’appel et dans le cadre de la réplique et elle est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l’attentat a été réalisé avec des explosifs. Cette partie de la conclusion de la Chambre de première instance demeure valable. Cependant la Chambre d’appel estime que les éléments de preuve présentés en première instance et les moyens de preuve supplémentaires ne la convainquent pas, au-delà de tout doute raisonnable, que les explosifs utilisés ne pouvaient être obtenus sans l’autorisation de l’appelant.
Pour ce qui est de l’attaque du 18 juillet 1993 sur Stari Vitez, la Chambre d’appel considère que l’appelant n’a pas démontré qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure, comme l’a fait la Chambre de première instance, que l’appelant avait ordonné l’attaque du 18 juillet 1993 sur Stari Vitez. Cependant l’attaque du 18 juillet 1993 ne peut être définie catégoriquement comme un acte criminel, étant donné qu’il y avait encore à ce moment-là un nombre considérable de soldats de l’ABiH à Stari Vitez.
Sur la base des éléments de preuve présentés en première instance et des moyens de preuve supplémentaires, la Chambre d’appel n’est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’attaque du 18 juillet 1993 ait entraîné de lourdes pertes parmi les civils musulmans suite à l’emploi des « bébés-bombes », ni que l’attaque ait été dirigée contre la population civile musulmane ou les biens lui appartenant à Stari Vitez.
La Chambre d’appel conclut que les éléments de preuve présentés en première instance et les moyens de preuve supplémentaires ne montrent pas, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant a ordonné l’attaque en sachant qu’il était très probable que les « bébés-bombes » seraient utilisées au cours de celle-ci contre la population musulmane civile ou contre les biens lui appartenant. La conclusion selon laquelle l’appelant a ordonné l’attaque, commettant par là même un crime contre l’humanité, est donc annulée.
S’agissant des crimes commis en avril et septembre 1993 à Donja Večeriska, Gačice et Grbavica, la Chambre de première instance a conclu que les villages attaqués auraient pu présenter un intérêt militaire justifiant qu’ils fassent l’objet d’une offensive et a également déclaré l’appelant coupable de crimes incluant des destructions, des pillages et des transferts forcés de civils, au motif qu’il avait ordonné des attaques « dont il ne pouvait que raisonnablement prévoir qu’elles conduiraient à des crimes ». La Chambre d’appel a appliqué à ces faits le critère juridique approprié et estime que les éléments de preuve présentés en première instance ne démontrent pas au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant a ordonné les attaques sur les villages en question en sachant qu’il était très probable que des crimes seraient commis au cours de ces opérations.
La Chambre d’appel annule les déclarations de culpabilité prononcées contre l’appelant sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les crimes commis dans les trois villages concernés.
b) Responsabilité de l’appelant au sens de l’article 7 3) du Statut
Il reste à déterminer si l’appelant doit être tenu responsable au sens de l’article 7 3) du Statut pour ces attaques.
S’agissant de l’attaque du 16 avril 1993 et de l’explosion du camion piégé du 18 avril 1993, la Chambre d’appel estime qu’aucune conclusion du Jugement et aucun élément de preuve ne démontrent que l’appelant savait ou avait des raisons de savoir avant les attaques que des unités placées sous son commandement s’apprêtaient à commettre des crimes. En conséquence, la question du manquement de l’appelant à son obligation d’empêcher ces crimes ne se pose pas au sujet de ces deux événements.
Quant à l’attaque du 18 juillet 1993 sur Stari Vitez, aucune constatation ni élément de preuve ne montrent que l’appelant savait ou avait des raisons de savoir au préalable que des « bébés-bombes » seraient utilisées au cours de l’attaque. En conséquence la question du manquement de l’appelant à son obligation d’empêcher l’emploi de ces bombes contre des cibles civiles n’a pas lieu d’être.
La Chambre d’appel considère donc sur la base des constatations rendues en première instance et des moyens de preuve versés au dossier en appel que la question du manquement de l’appelant à son obligation d’empêcher la perpétration d’un crime, au sens de l’article 7 3) du Statut, ne se pose pas pour ce volet de l’affaire.
L’appelant fait valoir en outre que les moyens de preuve supplémentaires démontrent que l’unité des Vitezovi ne relevait pas de son commandement et agissait fréquemment sur les ordres directs de Kordic et du Ministčre de la défense de Mostar.
S’agissant du contrôle effectif exercé par l’appelant sur les Vitezovi, la Chambre d’appel est convaincue au-delà de tout doute raisonnable, sur la base des éléments de preuve présentés en première instance ainsi que des moyens supplémentaires, que l’appelant avait le commandement de jure de cette unité. Si l’on considère que le fait de signaler les agissements criminels de ses subordonnés aux autorités compétentes est l’indicateur manifeste de la capacité matérielle, même très limitée, d’un supérieur de punir dans des circonstances données, on peut dire qu’en l’espèce l’appelant disposait de cette capacité limitée. En conséquence sa responsabilité de supérieur hiérarchique est mise en cause.
La Chambre de première instance n’a pas fourni suffisamment de faits à l’appui de sa conclusion sur le manquement de l’appelant à son obligation de punir, les Vitezovi notamment, pour les crimes commis dans la ville de Vitez. L’absence de toute analyse des moyens de preuve pertinents se rapportant à un élément-clé dans la détermination de la responsabilité pénale de l’appelant justifie à elle seule l’annulation des déclarations de culpabilité prononcées contre l’appelant sur la base de l’article 7 3) du Statut.
Cependant, la Chambre de première instance n’a pas analysé les éléments avancés par l’appelant au cours du procès et selon lesquels il a pris l’initiative d’une enquête sur l’explosion du camion piégé le 18 avril 1993 et informé ses supérieurs du résultat de cette enquête avant de leur signaler l’attaque menée par les Vitezovi le 18 juillet 1993 sur Stari Vitez. Pour le premier de ces deux incidents, aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure, à l’instar de la Chambre de première instance, que l’appelant avait manqué à son obligation de punir.
S’agissant du rapport sur l’attaque du 18 juillet 1993, les moyens de preuve présentés en première instance et en appel ne convainquent pas la Chambre d’appel au-delà de tout doute raisonnable que les Vitezovi ont commis un acte criminel en employant des « bébés-bombes ». L’appelant n’ayant pas su que ses subordonnés utilisaient ces « bébés-bombes » pendant l’attaque, la question de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique ne se pose pas.
En ce qui concerne l’offensive du 16 avril 1993, aucun juge du fait n’aurait raisonnablement pu, en l’absence d’éléments factuels suffisants, conclure comme l’a fait la Chambre de première instance, que l’appelant devait être considéré comme responsable au sens de l’article 7 3) des crimes commis au cours de cette attaque du Statut en raison d’un manquement à son obligation de punir.
7. Erreurs alléguées concernant la responsabilité de l’appelant pour les crimes commis dans la municipalité de Busovača
La Chambre de première instance a déclaré l’appelant responsable des attaques sur les villages de Lončari et d’Ocehnici en avril 1993. La Chambre de première instance a également conclu qu’en donnant des ordres à la police militaire en avril 1993, l’appelant avait intentionnellement pris le risque de voir des actes criminels très violents en résulter.
L’appelant soutient qu’il n’a jamais donné l’ordre d’attaquer Lončari ou Ocehnici et que la Chambre de première instance s’est trompée en lui imputant des crimes commis par la police militaire, et notamment par les Jokeri.
Après examen des constatations de la Chambre de première instance rappelées ci-dessus, la Chambre d’appel estime que la conclusion de la Chambre de première instance a été rendue sur la base de l’article 7 1) du Statut. La Chambre d’appel va appliquer le critère juridique qui convient pour déterminer si l’appelant est responsable au sens de l’article 7 1) des crimes commis à Lončari et d’Ocehnici.
En l’absence d’éléments de preuve directs montrant que l’appelant a ordonné les attaques de Lončari et d’Ocehnici en avril 1993, la Chambre d’appel estime qu’aucun juge du fait ne saurait raisonnablement conclure, au-delŕ de tout doute raisonnable, que l’appelant a donné l’ordre de procéder à ces attaques. La Chambre d’appel constate que les moyens de preuve supplémentaires admis en appel ne font que renforcer cette conclusion. En conséquence, il n’y a pas lieu de déterminer si oui ou non l’appelant savait qu’il était très probable que ces crimes allaient être commis.
Vu les arguments des parties sur ce point, et afin de faire toute la lumière sur cette question, la Chambre d’appel estime également nécessaire d’examiner la conclusion apparemment rendue par la Chambre de première instance selon laquelle l’appelant est responsable d’avoir mené à bien – et non pas ordonné – les attaques de janvier 1993 à Busovača. La Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance n’a analysé aucun élément de preuve relatif à la responsabilité de l’appelant dans les crimes commis à Busovača en janvier 1993, pas plus qu’elle n’a évalué cette responsabilité. En conséquence la Chambre d’appel considère qu’aucune conclusion n’a été tirée en application de l’article 7 1) du Statut au sujet des attaques de janvier 1993 sur Busovača.
Quant à la responsabilité de l’appelant en tant que supérieur hiérarchique pour les crimes commis à Busovača, la Chambre d’appel est d’avis que la Chambre de première instance n’a ni examiné, ni analysé de manière satisfaisante les éléments de preuve qui lui ont été présentés, au regard des conditions juridiques requises pour l’application de l’article 7 3) du Statut. De ce fait, la Chambre d’appel estime qu’aucune conclusion n’a été tirée en application de l’article 7 3) du Statut pour les crimes commis à Lončari et Ocehnici en avril 1993 et se refuse ŕ poursuivre plus avant l’examen de cette question.
À propos du chef 14 de l’acte d’accusation concernant la destruction d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement, l’appelant fait valoir que le Jugement est vague et n’identifie pas les preuves desdites destructions à Busovača. Dans son dispositif, la Chambre de première instance déclare l’appelant coupable du chef 14 sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut. Pourtant, dans la partie du Jugement relative à Busovača, on ne trouve ni discussion ni analyse des accusations portées sous le chef 14, ni conclusion précise de la Chambre. Par ces motifs, la Chambre d’appel estime qu’il convient d’annuler la déclaration de culpabilité prononcée s’agissant du chef 14 de l’acte d’accusation pour les événements de Busovača.
8. Erreurs alléguées concernant la responsabilité de l’appelant pour les crimes commis dans la municipalité de Kiseljak
La Chambre d’appel considère que la Chambre de première instance n’a pas conclu que l’appelant avait ordonné la perpétration des crimes d’avril 1993 à Kiseljak, mais a plutôt estimé que l’appelant avait « intentionnellement pris le risque » que les Musulmans et leurs biens soient les premiers visés par ces offensives et qu’il « devait savoir », lorsqu’il a donné l’ordre de procéder à ces attaques, que des actions criminelles très violentes en résulteraient. La Chambre d’appel va appliquer le critère juridique qui convient pour déterminer si l’appelant est responsable au sens de l’article 7 1) du Statut pour les crimes commis en avril 1993 à Kiseljak.
La Chambre d’appel observe que la Chambre de première instance a conclu que, par ces offensives et les moyens militaires employés, l’appelant visait à faire fuir ces populations. Il semble à la Chambre d’appel que la Chambre de première instance a estimé que l’appelant avait l’intention, au moyen de ces offensives, de procéder à des transferts forcés de civils.
Quand elle a affirmé que l’appelant avait intentionnellement pris le risque que les civils musulmans et les biens leur appartenant soient les premiers visés par les offensives lancées le 18 avril 1993, la Chambre de première instance s’est appuyée sur les ordres de préparation au combat (D299) et de combat (D300). Elle a estimé qu’ils avaient une teneur catégorique et haineuse et que l’appelant avait utilisé dans ces ordres des termes qui n’étaient pas strictement militaires et qui avaient une connotation émotionnelle de nature à inciter à la haine et à la vengeance contre les populations musulmanes. La Chambre de première instance a par ailleurs considéré que l’appelant avait employé des mots radicaux ayant une connotation d’« élimination », en citant à titre d’exemple l’expression « nettoyer le terrain », extraite du document D300.
La Chambre d’appel estime que les moyens de preuve présentés en première instance montrent que les ordres émis par l’appelant s’expliquaient par des considérations militaires. La Chambre conclut que, sur la base des éléments de preuves pris en compte par la Chambre de première instance, aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant avait l’intention de procéder à des transferts forcés de civils. La Chambre d’appel estime par ailleurs que ces éléments de preuve ne démontrent pas au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant savait qu’il était très probable que des crimes seraient perpétrés lors de l’exécution de ses ordres. Par ces motifs, la Chambre d’appel conclut qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure que la responsabilité de l’appelant est engagée sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les crimes commis en avril 1993 à Kiseljak.
Les moyens de preuve supplémentaires présentés en appel confirment que les termes utilisés dans le document D300 n’évoquent pas forcément les idées d’élimination ou de transfert forcé.
En ce qui concerne les attaques de juin 1993 à Kiseljak, la Chambre d’appel observe que, lorsqu’elle a conclu que l’appelant avait donné l’ordre de procéder à ces attaques, la Chambre de première instance n’a fait référence à aucun élément de preuve. On ne trouve en effet dans le dossier aucun élément montrant que l’appelant a ordonné ces attaques. La Chambre d’appel estime qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant avait ordonné les attaques de juin 1993 à Kiseljak. En conséquence, il n’y a pas lieu de se demander si l’appelant savait qu’il était très probable que des crimes allaient être commis. La Chambre d’appel conclut donc qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure que la responsabilité de l’appelant est engagée sur la base de l’article 7 1) du Statut pour les crimes commis en avril 1993 à Kiseljak.
La Chambre d’appel constate de plus qu’on ne trouve dans le Jugement aucune discussion sur la responsabilité de l’appelant au sens de l’article 7 3) du Statut pour des crimes commis en avril et juin 1993. En conséquence, la Chambre d’appel conclut qu’aucune conclusion n’a été tirée en ce qui concerne la responsabilité au sens de l’article 7 3) au sujet des attaques de juin 1993 à Kiseljak et se refuse à examiner la question plus avant.
9. Erreurs alléguées concernant la responsabilité de l’appelant pour les crimes liés à la détention
Les chefs d’accusation 15 à 20 du deuxième acte d’accusation modifié sont examinés dans une section du Jugement de la Chambre de première instance intitulée « crimes liés à la détention », car ils touchent tous à la privation de liberté.
a) Chefs d’accusation 15 et 16 : traitements cruels et inhumains
La Chambre de première instance a jugé l’appelant coupable, sur la base de l’article 7 3) du Statut, des crimes commis dans différents établissements de détention et, sur la base de l’article 7 1) du Statut, des crimes liés au creusement des tranchées.
La Chambre d’appel considère que le texte du Jugement en première instance n’est pas suffisamment clair quant aux motifs par lesquels la Chambre de première instance est parvenue à la conclusion que l’appelant avait ordonné les détentions ; il s’agit d’une conclusion tirée par extrapolation. Par conséquent, la Chambre d’appel estime qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure que l’appelant a ordonné les détentions, et annule la conclusion de la Chambre de première instance.
La Chambre de première instance a également conclu que l’appelant était coupable, sur la base de l’article 7 1) du Statut, d’avoir ordonné que les détenus creusent des tranchées ainsi que du traitement dont ils ont souffert par voie de conséquence. La Chambre d’appel constate que l’utilisation de personnes ne participant pas activement aux hostilités pour l’édification de fortifications militaires, qui seront utilisées lors d’opérations menées contre les forces avec lesquelles ces personnes s’identifient ou sympathisent, constitue une atteinte grave à la dignité humaine et cause de grandes souffrances mentales ou de graves atteintes à l’intégrité mentale (et, selon les cas, de grandes souffrances physiques ou de graves atteintes à l’intégrité physique) et que tout ordre destiné à forcer des personnes qui ne participent pas activement aux hostilités à creuser des tranchées ou à préparer d’autres installations militaires constitue dans ces conditions un traitement cruel.
Par conséquent, la Chambre d’appel estime qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que l’appelant a violé les lois ou coutumes de la guerre, en infraction de l’article 3 du Statut, et est coupable, sous le chef d’accusation 16, d’avoir donné l’ordre d’utiliser les détenus afin qu’ils creusent des tranchées.
De surcroît, la Chambre de première instance a conclu que l’appelant, en ordonnant le travail forcé, a, en connaissance de cause, pris le risque que ses soldats puissent commettre des actes violents contre des détenus vulnérables. La Chambre d’appel observe qu’il n’y a pas suffisamment de preuves permettant de tirer la conclusion, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant a donné l’ordre d’utiliser les détenus afin de creuser des tranchées, en sachant qu’il était probable que des crimes seraient commis dans l’exécution de ces ordres. Au contraire, s’il existe bien des preuves que l’appelant a ordonné que des tranchées soient creusées par des détenus dans des cas précis, ces preuves ne permettent pas d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant a donné de tels ordres en sachant qu’il était probable que des crimes seraient commis. Par conséquent, l’appelant n’est pas coupable des chefs d’accusation 15 et 16, sur la base de l’article 7 1) du Statut, pour les crimes liés au creusement des tranchées.
La Chambre d’appel considère que la Chambre de première instance a conclu que l’appelant connaissait les circonstances et conditions de détention des Musulmans dans les lieux de détention et que, en tout état de cause, il n’a pas exercé la diligence nécessaire et raisonnable dans l’accomplissement de ses devoirs.
Les moyens de preuve présentés en première instance montrent que l’appelant savait parfois que des mauvais traitements étaient infligés aux Musulmans de Bosnie non combattants dans des lieux de détention. En outre, la Chambre d’appel a étudié des éléments de preuve des dossiers de première instance indiquant que des détenus se trouvaient dans des endroits très proches du quartier général de l’appelant à Vitez, à savoir le centre culturel de Vitez (où se trouve le cinéma) et le poste vétérinaire de Vitez.
La Chambre d’appel estime que tout juge du fait aurait pu conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant savait que des détenus avaient été placés, en toute illégalité, au centre culturel de Vitez (où se trouve le cinéma) et au poste vétérinaire de Vitez, et qu’il savait que les conditions de leur détention étaient illicites. Cette conclusion n’a pas été infirmée par les moyens de preuve admis en appel.
La Chambre d’appel est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que, même s’il savait que des crimes liés à la détention étaient commis au centre culturel de Vitez et au poste vétérinaire de Vitez, l’appelant n’a pas puni ses subordonnés qui en étaient responsables et sur lesquels il était en mesure d’exercer un contrôle effectif, et n’a pas non plus présenté un rapport relatif aux infractions dont il avait connaissance aux autorités compétentes. En conséquence, l’appelant est coupable, sous le chef d’accusation 15, d’infractions graves aux Conventions de Genève (traitements inhumains), sanctionnées par les articles 2 b) et 7 3) du Statut.
b) Chefs d’accusation 17 et 18 : prise d’otages
La Chambre de première instance a reconnu l’appelant coupable de prise d’otages, perpétrée premièrement aux fins d’échanges de prisonniers, et deuxièmement aux fins de faire cesser les opérations militaires de l’ABiH contre le HVO.
La Chambre de première instance a conclu que l’appelant n’a pas ordonné que des otages soient pris ou utilisés, mais que certains détenus ont été « menacés de mort » afin d’empêcher la progression de l’ABiH sur Vitez, et que l’appelant en était responsable du fait qu’il avait ordonné de défendre Vitez.
La Chambre d’appel considère qu’il ne s’ensuit pas que la responsabilité pénale de l’appelant est engagée si d’autres personnes ont choisi d’exécuter de façon illicite son ordre légitime. Il n’y a pas nécessairement de lien de causalité entre un ordre de défense d’une position et la prise d’otages, et la Chambre de première instance a eu tort de l’établir.
La conclusion de la Chambre de première instance n’est pas étayée par les moyens de preuve, et aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement parvenir à ladite conclusion. Les conclusions de la Chambre de première instance relatives à la prise d’otages sont annulées.
c) Chefs d’accusation 19 et 20 : boucliers humains
La Chambre de première instance a estimé que l’appelant avait donné l’ordre d’utiliser des détenus comme boucliers humains pour protéger son quartier général, à l’hôtel Vitez, le 20 avril 1993, ce qui a infligé aux personnes concernées des souffrances mentales considérables.
L’utilisation de prisonniers de guerre ou de détenus civils comme boucliers humains est interdite par les dispositions des Conventions de Genève, et peut constituer un traitement inhumain ou cruel en vertu respectivement des articles 2 et 3 du Statut lorsque les autres éléments constitutifs de ces crimes sont réunis. L’utilisation de détenus protégés comme boucliers humains représente une infraction aux Conventions de Genève et ce, que ces boucliers humains aient été effectivement attaqués ou non, ou qu’il y ait eu ou non atteinte à leur intégrité physique ou mentale. En effet, l’interdiction vise à protéger les détenus du risque d’une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, et pas seulement d’une atteinte effective à leur intégrité physique ou mentale. Dans la mesure où la Chambre de première instance a considéré l’intensité des bombardements de Vitez, le 20 avril 1993, cette considération était superflue pour l’analyse d’une infraction aux Conventions de Genève, mais elle peut être pertinente pour déterminer si l’utilisation de détenus protégés comme boucliers humains représente un traitement inhumain au sens de l’article 2 du Statut.
La Chambre de première instance n’a été saisie d’aucun moyen de preuve lui permettant de conclure que l’appelant a positivement donné l’ordre d’utiliser les détenus comme boucliers humains. La Chambre d’appel estime que le raisonnement suivi par la Chambre de première instance pour conclure que l’appelant est responsable d’avoir positivement ordonné l’utilisation de détenus civils comme boucliers humains ne tient pas. Ce n’est pas parce que l’on a constaté que des détenus ont effectivement été utilisés comme boucliers humains en une occasion précise qu’il faut en déduire que l’appelant a ordonné positivement de le faire.
Cependant, une déclaration de culpabilité sur la base de l’article 7 1) du Statut ne sanctionne pas seulement l’acte positif de donner des ordres. La Chambre d’appel remarque qu’il était reproché à l’appelant, dans le deuxième acte d’accusation modifié, d’avoir – par ses actes et omissions – planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé ou encouragé à planifier, préparer ou exécuter les traitements illicites et inhumains de Musulmans de Bosnie. Par conséquent, le deuxième acte d’accusation modifié met, à juste titre, l’appelant en accusation pour d’autres formes de participation, en sus de l’acte positif consistant à donner des ordres, sur la base de l’article 7 1) du Statut. En particulier, la responsabilité pénale pour une omission, sur la base de l’article 7 1) du Statut, est expressément envisagée dans le deuxième acte d’accusation modifié.
La Chambre d’appel considère que l’utilisation de détenus comme boucliers humains a représenté une atteinte grave à leur intégrité mentale ainsi qu’une atteinte grave à la dignité humaine, et conclut qu’il était fondé de déclarer l’appelant coupable sous le chef d’accusation 19 pour l’utilisation de boucliers humains. Néanmoins, en l’absence d’éléments de preuve indiquant qu’il a ordonné positivement d’utiliser des boucliers humains, la responsabilité pénale de l’appelant est à juste titre définie comme découlant d’une omission, sur la base de l’article 7 1), comme indiqué dans le deuxième acte d’accusation. En conséquence, la Chambre d’appel conclut que les éléments constitutifs des traitements inhumains sont réunis et que, sur la base de l’article 7 1), l’appelant est coupable, en vertu de l’article 2 b) du Statut, des traitements inhumains qu’ont subis les détenus à l’occasion de leur utilisation en tant que boucliers humains.
10) Appel formé contre la peine
La Chambre de première instance a condamné l’appelant à une peine de quarante-cinq ans de prison, et l’appelant a interjeté appel de cette peine. L’appelant avance que la peine prononcée à son encontre devrait être annulée.
Dans ses précédents arrêts, la Chambre d’appel a souligné que la fixation de la peine est une décision relevant de l’appréciation des juges et qu’il n’est pas opportun d’établir une liste définitive de principes directeurs relatifs à la peine. La peine doit toujours être fixée en fonction des faits propres à chaque affaire et à la culpabilité individuelle de l’auteur des crimes.
En l’espèce, la Chambre d’appel a entendu plusieurs arguments présentés par l’appelant contre la peine prononcée par la Chambre de première instance. Ces arguments ont été pris en considération dans l’Arrêt de la Chambre d’appel mais pour l’essentiel, ils ne seront pas abordés à cette audience, par souci de brièveté.
Toutefois, la Chambre d’appel considère qu’il était erroné de la part de la Chambre de première instance d’avancer qu’« il n’est pas possible d’identifier quels faits seraient concernés par les différents chefs d’accusation que ceux supportant la poursuite et la condamnation au titre du chef 1 – Persécution ». Étant donné qu’il n’est pas possible d’identifier quels faits seraient concernés par les différents chefs d’accusation, il n’est pas non plus possible de parvenir à prononcer des déclarations de culpabilité distinctes. Soit l’accusé est coupable de différents crimes constitués par différents éléments qui peuvent parfois se recouper (mais jamais entièrement), soit il est déclaré coupable du crime comportant les éléments les plus spécifiques, et les autres chefs d’accusation qui prennent aussi en compte ces éléments sont alors à rejeter, au motif qu’ils sont cumulatifs, ce qui ne peut être admis. La Chambre d’appel conclut que le raisonnement de la Chambre de première instance comporte une erreur de droit. La Chambre de première instance a également commis des erreurs, lorsqu’elle n’a pas tenu compte des remords réels et sincères de l’appelant comme circonstance atténuante, et lorsqu’elle a considéré son intention discriminatoire comme un facteur aggravant, compte tenu de sa déclaration de culpabilité pour persécutions.
La Chambre d’appel a fait droit à une partie de l’appel formé contre la peine. Toutefois, l’application des critères établis pour la révision de la sentence ne serait pas opportune en l’espèce. Dans le cadre de cet appel, il incombe à la Chambre d’appel non pas simplement de confirmer ou de réviser la peine fixée par la Chambre de première instance, mais de prononcer une nouvelle peine. Au lieu de réviser la peine de la Chambre de première instance, la Chambre d’appel va la remplacer par sa propre sentence motivée, sur la base de ses propres conclusions, estimant être en droit de s’acquitter de cette fonction en l’espèce, sans renvoyer l’affaire devant la Chambre de première instance.
La Chambre d’appel remarque qu’aucune preuve n’a été présentée pour mettre en doute la moralité de l’appelant, mais que plusieurs témoins se sont en revanche évertué à faire valoir son intégrité, le traitement équitable qu’il a réservé aux Musulmans de Bosnie à la fois avant et pendant la guerre, son absence de partialité à l’encontre de ces derniers et sa conscience professionnelle de soldat. Des preuves relatives au respect qu’éprouvaient pour lui ses opposants de l’ABiH ont aussi été avancées et plusieurs témoins ont attesté qu’il est un homme de devoir. De plus, l’appelant est père de jeunes enfants.
Dans son examen des facteurs à considérer pour fixer la peine, la Chambre d’appel a identifié les éléments suivants comme des circonstances aggravantes prouvées au-delà de tout doute raisonnable : i) la position de l’appelant en tant que colonel du HVO et en tant que commandant des forces régionales dans la zone opérationnelle de la Bosnie Centrale ; et ii) le fait que de nombreuses victimes des crimes dont l’appelant a été jugé coupable étaient des civils.
Les circonstances atténuantes prouvées sur la base de l’hypothèse la plus probable sont les suivantes : i) la reddition volontaire de l’appelant au Tribunal international ; ii) ses remords exprimés de façon sincère et véritable ; iii) sa bonne moralité et son casier judiciaire vierge ; iv) sa bonne conduite au procès et pendant sa détention ; v) sa situation personnelle et familiale, notamment son mauvais état de santé ; vi) le fait qu’il a été détenu pendant plus de huit ans en attendant que l’affaire soit menée à son terme ; et vii) les circonstances qui lui étaient propres au début de la guerre et durant celle-ci.
L’article 87 C) du Règlement prévoit qu’une Chambre peut décider d’exercer son pouvoir de prononcer une peine unique en sanctionnant l’ensemble du comportement criminel de l’accusé, et la Chambre d’appel décide de prononcer une peine unique dans cette affaire, étant donné que le comportement criminel pour lequel l’appelant a été déclaré coupable fait partie d’un comportement général similaire, et s’est inscrit dans un cadre temporel limité.
Je vais maintenant vous donner lecture du dispositif de l’Arrêt dans son intégralité.
Monsieur Blaskic, veuillez vous lever.
DISPOSITIF
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’APPEL,
EN APPLICATION de l’article 25 du Statut et des articles 117 et 118 du Règlement,
VU les écritures respectives des parties et leurs exposés aux audiences des 16 et 17 décembre 2003,
SIÉGEANT en audience publique,
REJETTE le moyen d’appel soulevé par l’appelant relatif à la violation du droit à une procédure régulière,
ACCUEILLE, à la majorité, le Juge Weinberg de Roca étant en désaccord, le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Ahmici, Šantici, Pirici et Nadioci le 16 avril 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour ces crimes (chefs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14), et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 3) du Statut pour ces crimes (chefs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14),
ACCUEILLE, à l’unanimité, le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis dans la municipalité de Vitez ailleurs qu’à Ahmici, Šantici, Pirici et Nadioci en avril, juillet et septembre 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour ces crimes (chefs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14), et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 3) du Statut pour ces crimes (chefs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14),
ACCUEILLE, à l’unanimité, le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Lončari et à Ocehnici, dans la municipalité de Busovača, en avril 1993, ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour ces crimes (chefs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14), et DIT que la Chambre de première instance n’a tiré aucune conclusion en application de l’article 7 1) du Statut concernant les attaques lancées en janvier 1993 à Busovača, pas plus qu’elle n’en a tiré en application de l’article 7 3) du Statut concernant les crimes commis à Lončari et à Ocehnici en avril 1993,
ACCUEILLE, à l’unanimité, le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis en avril 1993 à Kiseljak, ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de l’article 7 1) du Statut pour ces crimes (chefs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14), et DIT que la Chambre de première instance n’a tiré aucune conclusion en application de l’article 7 3) du Statut concernant ces crimes,
ACCUEILLE, à l’unanimité, le moyen d’appel soulevé par l’appelant concernant sa responsabilité pour des crimes liés à la détention, dans la mesure où il est fait droit à l’appel interjeté contre les déclarations de culpabilité prononcées sur la base de l’article 7 1) du Statut sous les chefs 17, 18 et 20, et ANNULE les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sous ces chefs,
CONFIRME, à l’unanimité, les déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre de l’appelant pour 1) les crimes liés à la détention commis dans les établissements de détention en question, sur la base de l’article 7 3) du Statut (chef 15), 2) le fait d’avoir ordonné le recours à des personnes protégées pour construire des installations militaires de défense, sur la base de l’article 7 1) du Statut (chef 16), 3) les traitements inhumains infligés aux détenus du fait de leur utilisation comme boucliers humains, sur la base de l’article 7 1) du Statut (chef 19), et DIT que la Chambre de première instance n’a tiré aucune conclusion en application de l’article 7 3) du Statut pour ce qui est du recours à des personnes protégées pour construire des installations militaires de défense (chefs 15 et 16), de la prise d’otages (chefs 17 et 18), ou des traitements inhumains infligés aux détenus du fait de leur utilisation comme boucliers humains (chefs 19 et 20),
REJETTE, pour le surplus, l’appel interjeté par l’appelant contre les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre,
ACCUEILLE partiellement, à l’unanimité, le moyen d’appel soulevé par l’appelant contre la peine, et FIXE, à la majorité, le Juge Weinberg de Roca étant en désaccord, une nouvelle peine,
CONDAMNE l’appelant à une peine de neuf années d’emprisonnement à compter de ce jour, la durée de la période passée en détention préventive, soit du 1er avril 1996 à ce jour, étant à déduire de la durée totale de la peine, en application de l’article 101 C) du Règlement,
ORDONNE, en application des articles 103 C) et 107 du Règlement, que l’appelant reste sous la garde du Tribunal international jusqu’à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l’État dans lequel il purgera sa peine.
Le présent arrêt est signé par les Juges Mumba, Güney, Schomburg, Weinberg de Roca et moi-même, ce jour, 29 juillet 2004, à La Haye, Pays-Bas.
Le Juge Schomburg joint une opinion individuelle relative à la peine.
Le Juge Weinberg de Roca joint une opinion partiellement dissidente.
Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, distribuer des copies de l’Arrêt aux parties.
L’audience est levée.
***********
*****
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Bureau de presse à La Haye
Tél.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org ()Le TPIY sur Twitter et Youtube